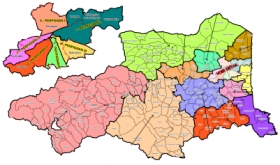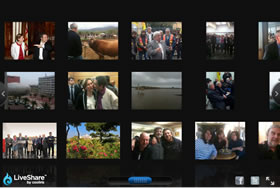(Communiqué)
Elie Puigmal, président du CLR 66, communique :
“La laïcité n’est pas une opinion, elle permet d’en avoir une”
-“Nous sommes heureux et honorés avec le bureau du CLR 66 de vous parler de la journée de la laïcité. Elle a lieu chaque année le 9 décembre. Cet exercice nous permet de faire le point et de prendre du recul sur les grands sujets d’actualité, comme la laïcité trop souvent malmenée, récupérée et/ou adjectivée.
La journée nationale de la laïcité, célèbre la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Églises et de l’État. Depuis cette date, les services publics doivent se montrer neutres vis-à-vis des religions, n’en favoriser ni en défavoriser aucune. Ces principes complémentaires, réunis sous le nom de laïcité, font l’objet d’interprétations divergentes qui suscitent encore ces dernières années de nombreux débats, par exemple sur le port de signes religieux à l’école publique. La loi de 1905 a été modifiée en 2021 par une loi « contre les séparatismes » qui comprend des mesures concernant les associations gérant des lieux de culte.
Pourquoi cela compte t-il autant pour nous de vous parler de la loi de 1905 ?
Promulguée le 9 décembre 1905, la loi concernant la séparation des Églises et de l’État, toujours en vigueur, pose deux principes complémentaires :
–« La République assure la liberté de conscience », la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion ou de ne pas en avoir.
–« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.» Les cultes s’organisent seuls : « L’Église chez elle et l’État chez lui », comme le déclarait Victor Hugo dans un discours en 1850. Les 40 autres articles de la loi régissent les relations entre l’État et les religions.
La laïcité
La laïcité est caractérisée par trois principes à valeurs constitutionnelles : la liberté de conscience qui est celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la séparation entre les institutions publiques et les organisations religieuses, l’égalité de tous devant la loi, selon le comité interministériel de la laïcité, qui a remplacé en 2021 l’Observatoire de la laïcité, une commission consultative mise en place en 2013 pour conseiller le gouvernement sur son respect, sa défense et sa promotion.
Pour votre information au CLR national nous avons des membres au sein du Comité interministériel de la laïcité. De la séparation entre l’État et les religions découle « la neutralité de l’État, des collectivités territoriales et des services publics », par laquelle ils ne manifestent aucune appartenance ni aucune préférence religieuse. Cette neutralité s’impose aux élus et aux agents publics et non aux usagers des services publics.
L’article 1er de la Constitution de la Ve République prévoit que :
-« la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
Les dates à retenir :
1881/1882 les lois Ferry.
Votées en 1881 et en 1882, deux lois auxquelles le ministre de l’Instruction publique Jules Ferry a donné son nom réforment l’école publique. Elles sont précédées d’une réforme en 1879 instaurant la formation par l’État d’instituteurs laïques, c’est-à-dire indépendant des organisations religieuses, pour remplacer les religieux qui se chargeaient jusque-là d’enseigner.
La loi du 16 juin 1881 établit la gratuité de l’école.
Celle du 28 mars 1882 fixe l’obligation de scolarité pour les filles et garçons âgés de 6 à 13 ans. Elle supprime tout enseignement religieux à l’école publique et le remplace par une instruction morale. En 1886, la loi Goblet prévoit que l’enseignement y soit « exclusivement confié à un personnel laïque ».
1903 les débats sur la loi de séparation.
En 1903 est constituée une commission parlementaire chargée d’élaborer un projet de loi sur la séparation des Églises et de l’État. Le contexte est celui d’un affrontement violent entre le gouvernement de l’époque et l’Église catholique. En 1902, le chef du gouvernement, Émile Combes, ordonne la fermeture de plusieurs milliers d’établissements scolaires où enseignent des religieux. En 1904, la France rompt ses relations diplomatiques avec le Vatican. Le 3 juillet 1905, après 48 séances de discussion, la Chambre des députés adopte le projet de loi de séparation des Églises et de l’État, par 341 voix contre 233.
2004 la loi sur les signes religieux à l’école.
En 1989, à Creil (Oise), trois collégiennes refusent de retirer leur foulard islamique en cours et sont exclues de leur établissement. Après plusieurs années de débats sur le port du voile par des élèves dans les collèges et les lycées publics, l’application de la laïcité à l’école évolue en 2004. Une nouvelle loi précise que « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ». Une circulaire de mai 2004 détaillant les modalités d’application de la loi explique qu’elle vise à préserver les écoles, collèges et lycées publics « des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles à des appartenances religieuses » et à garantir ainsi « la liberté de conscience de chacun ».
2021 une loi contre “les séparatismes.”
En juillet 2021, le Parlement adopte une loi « confortant le respect des valeurs de la République ». Ce projet de loi avait été présenté par le gouvernement en décembre 2020 dans le but de lutter «contre les séparatismes», pour dénoncer le fait que des personnes « entendent imposer la loi d’un groupe », « souvent au nom d’un Dieu, parfois avec l’aide de puissances étrangères ». Cette loi modifie la loi de 1905 en imposant aux associations gérant des lieux de culte de déclarer les dons étrangers de plus de 10 000 euros et la cession de lieux de culte à un État étranger, auxquels le préfet peut s’opposer. La loi restreint les conditions de l’éducation à domicile et crée un nouveau délit pour lutter contre la haine en ligne.
Notre position au CLR 66 est de vous mettre en garde contre certains partis politiques usant d’éléments de langage loin de ceux qui fondent la République tels que : “Liberté, Egalité, Fraternité” comme aussi la laïcité qui est une loi non contraignante, bien au contraire elle permet et autorise la liberté de conscience, la liberté d’expression de ses convictions dans le respect de celles d’autrui et dans les limites de l’ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. La laïcité permet l’exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité et la fraternité de tous dans le souci de l’intérêt général et ce quelles que soient leurs croyances et/ ou leurs religions.
Elie Puigmal