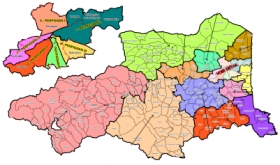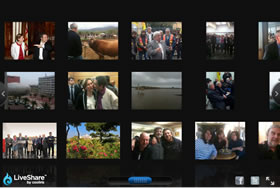(Communiqué)

L’Association des Amis de Collioure présente : conférence du 6 janvier 2024, par Georges Gensane – L’art de la mosaïque dans l’antiquité Des origines à l’époque paléochrétienne. Une exégèse historico critique (Centre Culturel à 17h)
Depuis ses lointaines origines en Mésopotamie, où les mosaïques nacrées n’étaient conçues que pour exalter et glorifier le pouvoir royal, et les premiers revêtements de galets de rivière apparus en Grèce archaïque, au VIIIe siècle, le décor de « mosaïque », cet « art digne des Muses », s’est imposé comme un des arts les plus représentatifs du monde antique.
L’adoption dans les mosaïques de galets de Pella en Macédoine du style illusionniste des grands peintres grecs, partis en quête de la célèbre « mimésis », grâce à l’invention de la « skiagraphia », ce procédé, qui permettait de produire des effets de profondeur grâce à la capture de la lumière et de l’ombre, a conduit ensuite l’Égypte hellénistique à remplacer les galets par des « tesselles », petits cubes de pierre taillés, « l’opus tessellatum » puis « l’opus vermiculatum ».
D’où ces inoubliables chefs d’œuvre, copies le plus souvent de tableaux célèbres, qui nous viennent d’Alexandrie, de Délos, de Nea Paphos, d’Antioche, de Pergame, de Lybie, de Préneste, de Piazza Armerina, de Pompéi, avec la fabuleuse Mosaïque d’Alexandre, et les deux célèbres « emblemata » signés par Dioscoride de Samos, transpositions en pierre de peintures de chevalet, où « le clair-obscur est obtenu par le seul moyen de la couleur ».
Avec l’avènement du christianisme, s’ouvrit un nouvel Âge d’or pour la « peinture de pierres », ainsi s’expliquent ces chefs d’œuvre de Madaba en Jordanie, Sainte-Catherine du Sinaï, Sainte Pudentienne, le Mausolée de Constance à Rome, Constantinople, Ravenne enfin.
« Vera pittura per l’eternità », les mosaïques paléochrétiennes, attachées désormais à représenter des valeurs symboliques et allégoriques, abandonneront dès lors les valeurs plastiques de la grande peinture grecque, au profit d’une inspiration plus intérieure et plus métaphysique, d’où ce refus du tridimensionnel, un recours quasi obsessionnel à la frontalité, l’abstraction, la stylisation, un art donc désormais symbolique, contemplatif, stylisateur, abstrait, hiératique, aux antipodes de la grande mosaïque gréco romaine…
*Georges Gensane est Professeur agrégé de Lettres Classiques, Professeur des Universités Honoraire – Université de Perpignan – Université de Beyrouth, Chargé de mission au Moyen Orient