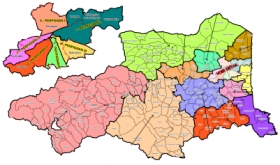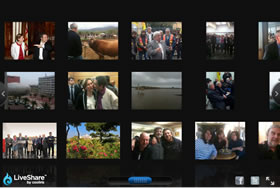Dossier des retraites/ “Le rapport de la Cour des comptes fera t’il taire les démagogues ?” : la contribution de Claude Barate*
par adminLuc le Mar 20, 2025 • 10 h 34 min Aucun commentaire*Par Claude Barate, universitaire, député honoraire
Ce dossier n’a d’autre but que celui d’aider les lecteurs dans leur réflexion. Etant donné qu’il est très dense, j’ai préféré l’organiser en parties
-Première partie : analyse générale des régimes de retraites.
A – Les divers systèmes de retraites. B – Analyse des diverse réformes paramétriques possibles
-Deuxième partie : réagir face à des chiffres inquiétants,
A – Les chiffres inquiétants de la Cour des comptes. B – Que peut-on faire face à une telle situation ?
Remarque préliminaire, à propos de la démagogie :
Dans l’Antiquité, le philosophe grec Aristote, par ailleurs précepteur d’Alexandre le Grand, s’évertuait à dire que « La démagogie est la forme la plus corrompue de la démocratie ».
Je ne peux que valider cette affirmation, lorsque je vois Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, continuer à revendiquer la retraite à 60 ans, après avoir pris connaissance du rapport de la Cour. Comme je ne veux pas l’injurier en disant qu’elle ne connait rien du dossier, je suis obligé de conclure que la démagogie est pour elle quelque chose de naturel. En effet c’est bien beau de dire qu’on veut la retraite à 60 ans, sans indiquer comment on finance un système déjà déficitaire. Malheureusement elle n’est pas la seule à être démagogue !
-Première partie : analyse générale des systèmes de retraites
A – LES DIVERS SYSTEMES DE RETRAITE
1re remarque, à propos du système dit de répartition.
Dans un système de répartition, ce sont les actifs qui payent pour les inactifs. Tout le monde doit donc comprendre que plus le nombre d’inactifs augmente et plus la charge est importante pour les actifs.
En 1945, lors de la création de la sécurité sociale par le gouvernement du Général de Gaulle, le ministre en charge du dossier, le communiste Amboise Croizat avait fixé l’âge de départ à la retraite à 65 ans alors que l’espérance de vie était de 65 ans. Il y avait donc beaucoup d’actifs pour peu de retraités.
En 1982, François Mitterrand a fixé l’âge de départ à la retraite à 60 ans, alors qu’aujourd’hui l’espérance de vie moyenne est proche de 84 ans. Cette réforme a eu comme conséquence d’augmenter le nombre de retraités et de diminuer le nombre des actifs. La charge sur le dos des actifs est devenue énorme.
2e remarque, sur le système de la retraite par points.
C’est le plus juste, puisque la retraite de chacun est calculée en fonction des points acquis par chacun pendant toute sa période d’activité. La valeur des points étant la même pour tout le monde.
Mais cela reste un système de répartition, dans lequel ce sont toujours les actifs qui cotisent pour les retraités. L’avantage du système est d’égaliser la participation de chacun et de ne plus avoir les différences criantes du système actuel dans lequel par exemple le calcul de la retraite des fonctionnaires est basé sur les six derniers mois de carrière alors que celui du privé l’est sur les 25 meilleures années. Ce système plus juste, pénaliserait par rapport à la situation actuelle, les fonctionnaires et les régimes spéciaux.
3e remarque, à propos du système de retraites par capitalisation.
C’est un système dans lequel la retraite est fonction du revenu du capital souscrit tout au long de sa carrière. C’est donc un système d’épargne individuel basé sur l’autofinancement. Pendant que le salarié est en activité, il épargne pour payer sa propre retraite et non celle des autres retraités. Cette retraite peut être principale, mais aussi complémentaire et, ou, facultative.
Elle est connue en France, notamment pour les fonctionnaires par le régime de la Préfonds, mais aussi pour des particuliers.
D’après une étude de Natixis de 2020, la capitalisation aurait eu un rendement bien plus élevé, que par la répartition, pour chaque euro cotisé depuis 1982. Néanmoins, la capitalisation entraine un risque du placement, le capital n’étant pas garanti. C’est pourquoi aucun pays au monde n’a choisi une capitalisation à 100%. Tous les pays ont des systèmes mixtes.
4e remarque, à propos de la nature des réformes.
On parle de réformes systémiques ou de réformes paramétriques. Encore faut-il savoir ce que cela signifie.
La réforme systémique a pour objectif de changer le système : par exemple si on passe de la retraite par répartition à la retraite par capitalisation, ou la réforme par points.
La réforme paramétrique a pour objectif de changer à l’intérieur d’un même système, les paramètres d’application : par exemple, dans le système de répartition, faire évoluer l’âge de départ à la retraite, le niveau des cotisations ou encore baisser le niveau des retraites.
5e remarque, sur les choix suivis jusqu’à présent.
Le principal marqueur choisi a été celui de l’âge de départ à la retraite. Nous avons vu comment François Mitterrand avait choisi, en 1982, de baisser l’âge de la retraite à 60 ans.
En 2010 Nicolas Sarkozy sera obligé de remonter progressivement l’âge à 62 ans, sous les critiques de la gauche socialiste.
Mais celle-ci, accédant à son tour au pouvoir en 2012, se gardera bien de revenir à 60 ans, tout en augmentant par la réforme Touraine, le nombre d’annuités nécessaires pour percevoir la retraite à taux plein, ce qui est aussi une manière de retarder l’âge de départ en retraite.
B – ANALYSE DES DIVERSES REFORMES PARAMETRIQUES POSSIBLES
6e remarque à propos de la technique utilisée trop souvent de recourir à l’emprunt pour équilibrer les caisses.
C’est le seul paramètre que l’on ne doit pas utiliser. Emprunter, cela veut dire qu’on fait rembourser par nos enfants, nos dépenses de fonctionnement actuelles. Autant il est logique que par le remboursement des emprunts, ils participent aux dépenses d’investissement qu’on leur laisse (routes, chemin de fer, écoles, hôpitaux, aéroports, ports universités etc),
Autant il serait gravement immoral de leur demander de rembourser nos dettes de fonctionnement.
Ce mode de financement doit être totalement banni.
7e remarque à propos d’une non indexation des retraites difficile à mettre en œuvre.
Ne pas indexer les retraites sur l’inflation, c’est baisser le pouvoir d’achat des retraités, chaque année, du montant de l’inflation et étrangler littéralement ceux qui ont de faibles retraites.
8e remarque, sur la quasi-impossibilité d’augmenter les charges sociales, autant celles des salariés que celles des entreprises.
Pour certains, il suffirait d’augmenter les cotisations des salariés et des entreprises. Je crois au contraire qu’il s’agirait là d’une erreur majeure.
L’augmentation de la contribution entrainerait ipso facto, une diminution du pouvoir d’achat des salariés, soit le contraire de ce qu’il faut faire.
Quant à l’augmentation de la cotisation patronale, elle se heurte à mon sens à 2 inconvénients majeurs :
● D’abord, augmenter les charges sociales, c’est augmenter le prix de revient et donc le prix de vente des produits : soit une mise en faiblesse de nos entreprises par rapport aux entreprises étrangères.
● Ensuite, augmenter les charges, qui sont déjà parmi les plus élevées au monde, c’est peser sur le pouvoir d’achat des salariés ou mettre l’entreprise en péril.
En résumé, plus les charges sociales sont élevées, plus le pouvoir d’achat des salariés est faible et plus les entreprises sont en difficulté, notamment face à la concurrence internationale. Et la perte de compétitivité signifie la perte d’emplois en France.
C’est là que réside les faiblesses françaises d’un pouvoir d’achat faible.
9e remarque, sur le choix de relever l’âge de la retraite pour équilibrer le régime.
Dans un système de retraite par répartition, c’est la méthode qui rapporte le plus pour équilibrer les caisses de retraite. En effet, chaque fois qu’on augmente l’âge de départ à la retraite, on crée théoriquement un cotisant de plus (celui qui doit attendre pour prendre sa retraite) et un bénéficiaire de moins (celui qui n’as pas pris sa retraite). C’est pourquoi c’est la réforme utilisée par la plupart des pays européens, avec une moyenne d’âge de départ à la retraite de 66 ans.
Deuxième partie : réagir face à des chiffres inquiétants
A – LES CHIFFRES INQUIETANTS DE LA COUR DES COMPTES
L’avantage d’un rapport fait par les magistrats de la Cour est de rendre difficilement contestables les chiffres qui y sont annoncés : fini les évaluations fantaisistes, même si des analyses différentes pouvaient être faites :
● D’abord, celle d’une situation de l’emploi différente Bien sûr, les recettes ayant comme base le travail, on pourra toujours dire que les évaluations pourraient être différentes en fonction du nombre de personnes ayant un emploi, en fonction du taux de chômage, ou encore en fonction du taux d’emploi des séniors. La Cour, écartant ces éléments, retient simplement la situation économique actuelle. Et tant mieux si les résultats de l’emploi arrivaient à être meilleurs que prévus.
● Ensuite, fallait-il compter les subventions d’équilibre, versées par l’Etat, comme des recettes normales ?
En effet la Cour a comptabilisé comme recettes normales, les subventions d’équilibre versées par l’Etat pour ses régimes spéciaux et d’abord celui de la fonction publique. Pourtant, ces subventions sont bien le financement d’un déficit.
Sans cela, les déficits annoncés, seraient augmentés d’autant.
Mais admettons !
10e remarque, les déficits prévisibles avec l’application de la loi de 2023, poussant l’âge de départ à 64 ans, imposeront quand même, de nouvelles réformes.
Dès 2025, le système actuel, doit être déficitaire de 6,6 milliards d’euros et ce jusqu’à vers 2030, puis il devrait se dégrader encore jusqu’en 2045, avec 30 milliards. Autant dire qu’imaginer le retour d’une retraite à 60 ans est purement démagogique.
Certains syndicalistes ont alors critiqué la réforme de 2023 comme n’étant pas la dernière. Comme s’il pouvait y avoir dans un système de retraite par répartition une réforme définitive. Même un enfant de maternelle pourrait comprendre qu’il faut réformer le système au fur et à mesure que le rapport entre retraités et actifs varie.
Ce qui veut dire que si la réforme a été utile, elle ne sera pas suffisante.
11e remarque, la solidarité intergénérationnelle du système de retraite par répartition impose une adaptation permanente.et d’abord au niveau de l’âge de départ à la retraite.
Tout le monde peut comprendre que plus l’espérance de vie augmente et plus le déséquilibre est défavorable aux actifs, sauf à ce que la croissance démographique vienne corriger les équilibres avec une augmentation du nombre d’actifs.
C’est pourquoi, sans sortir du système dit de répartition, la Cour apporte d’autres éléments d’analyse.
● D’abord, elle indique que si on voulait revenir à un départ à 63 ans au lieu de 64, le déficit augmenterait de 5,8 milliards Ce qui veut dire qu’en 2035, le déficit total serait de l’ordre de 15 milliards plus 5,8 milliards soit 20,8 milliards.
● A contrario, le passage de 64 ans à 65 ans rapporterait 8,4 milliards et assurerait l’équilibre pour les dix ans à venir.
12e remarque, à propos de l’évolution du nombre d’annuités requises pour avoir droit à la retraite à taux plein.
La Cour estime que le recul de la situation actuelle de 43 annuités, nécessaires pour percevoir la retraite à taux plein, à 42 coûterait 3,9 milliards de plus en 2035, alors que le passage de 43 annuités à 44, rapporterait 5,2 milliards.
13e remarque, à propos de l’augmentation éventuelle des cotisations.
La Cour estime qu’une augmentation d’1 point des cotisations pourrait rapporter jusqu’à 7,6 milliards d’euros.
14e remarque, à propos de la sous indexation des retraites. (Sous indexer signifie choisir une augmentation des retraites inférieure à l’augmentation de l’inflation.)
La Cour estime que la sous indexation du régime de base des retraites permettrait de gagner cette même année 2025, la somme de 2,9 milliards d’euros.
B – QUE PEUT-ON FAIRE FACE A UNE TELLE SITUATION ?
Ce sont ces chiffres qui ont amené Pierre Moscovici à déclarer un état d’urgence. Quel que soit le scénario, il réduit à une démarche démagogique tous ceux qui voudraient baisser l’âge de départ à la retraite, que ce soit à 63 ans, 62 ou pire 60 ans.
François Bayrou a eu raison de renvoyer aux partenaires sociaux, le devoir de choisir une solution qui respecte l’impératif d’équilibre financier.
Ce sont vraisemblablement ces chiffres qui sont le vrai motif du retrait de certains syndicats, placés dans la contradiction des slogans face à la réalité des choses. Les chiffres sont têtus !
Je me permets tout de même quelques remarques.
15e remarque, à propos du recours à l’emprunt pour équilibrer.
J’ai déjà dit, dans la 1ère partie de ce dossier, combien il était immoral, scandaleux et donc impossible, d’accepter un système dans lequel on reporte sur nos enfants le remboursement de nos propres dépenses de fonctionnement. Je ne reviendrai pas sur le sujet.
16e remarque, sur l’âge de départ en retraite.
A écouter certains, le passage à 64 ans a été une décision anti sociale, antidémocratique etc. Je constate au contraire que même à 64 ans, la France est la championne européenne dans le départs plus tôt à la retraite. La plupart des pays européens sont à 66 ans et plus.
D’ailleurs ce départ de plus en plus tardif, est fonction de l’évolution de l’espérance de vie.
Tout le monde peut comprendre que l’augmentation de l’espérance de vie, accroit le nombre de retraités, et que l’âge de départ à la retraite doit évoluer en conséquence.
Ceci est d’autant plus nécessaire que le temps travaillé annuel est en France un des plus faible d’Europe.
17e remarque, à propos du temps de travail annuel.
C’est sur le total des heures travaillées, que les charges sociales s’appliquent pour constituer les recettes de la Sécurité Sociale Plus il y aurait d’heures travaillées et moins il serait nécessaire de travailler longtemps.
Or d’après les études Rexecode, le temps de travail annuel est en France de 1680 heures, un des plus bas en Europe après la Finlande et la Suède. A noter qu’il y a vingt ans, il était de 1955 heures
La réforme socialiste des 35 heures par semaine est passée par là !
S’ajoute à cette situation, un taux d’emploi des actifs, le plus faible en Europe. (Le taux d’emploi correspond au pourcentage de personnes qui travaillent par rapport à celles qui sont en capacité de le faire).
A titre de repère, si le taux d’emploi moyen rejoignait celui de la moyenne supérieure en Europe, ce sont 2,3 millions d’emploi supplémentaires qui seraient au travail., cotiseraient en rétablissant les comptes de la Sécurité Sociale.
C’est sur l’insertion des jeunes et sur le maintien en emploi des séniors qu’il faut travailler tout en faisant en sorte qu’il soit plus intéressant de travailler que de vivre de l’aide sociale.
Cette politique doit impérativement être développée. En attendant ses effets éventuels, il est impossible d’en rentrer des effets encore inexistants dans les paramètres de calcul.
Comme on est loin des politiques socialistes qui ont poussé, depuis 30 ans à travailler moins, alors qu’il fallait se battre pour travailler mieux, pour que chacun trouve dans son travail, le moyen de se réaliser et d’aller avec plaisir à la rencontre des autres.
18e remarque, à propos de l’augmentation éventuelle des charges sociales.
Ce n’est pas la bonne solution. Toute augmentation des charges sociales a pour conséquence d’augmenter le prix des produits, de faire perdre de la compétitivité aux produits français par rapport aux produits importés et entraine une baisse du pouvoir d’achat des salariés.
C’est l’exemple parfait du cercle vicieux, que les syndicats n’ont pas vu venir. La retraite à 60 ans et la semaine de 35 heures ont été présentées comme des avancées sociales alors qu’en réalité elles ont eu des conséquences néfastes : elles ont réduit le nombre de personnes au travail et donc augmenté les charges sociales des autres. La conséquence réelle a été une diminution du pouvoir d’achat, une dégradation de la balance commerciale et une diminution des emplois en France.
19e remarque, sur la baisse du pouvoir d’achat des retraités.
S’il est vrai que le niveau de revenu des retraités est parfois meilleur que celui des actifs, ce n’est pas parce qu’ils auraient des retraites supérieures aux salaires des actifs, mais parce qu’ils ont tout au long de leur carrière économisé pour acheter résidence principale et autres.
En réalité leur revenu est souvent diminué de l’aide qu’ils apportent à leurs enfants et petit-enfants, parfois à des actions d’intérêt général.
Si un effort doit leur être demandé, il ne peut qu’être léger, temporaire et il ne doit pas concerner les petites retraites.
20e remarque, sur l’évolution de l’espérance de vie et ses conséquences en termes de retraite.
Grâce aux progrès de la science, l’espérance de vie s’accroit.
Elle était en moyenne, en 1945, lorsqu’a été créée la Sécurité Sociale, de 65 ans. Elle est aujourd’hui de 80 ans pour les hommes et de 85,6 ans pour les femmes. D’après les prévisions, elle devrait être de 86 ans pour les hommes en 2050 et de 94 ans pour les femmes.
Autant dire que, sauf à monter l’âge de départ à la retraite à plus de 70 ans, le système de répartition, tel qu’il est aujourd’hui ne résistera pas.
● En conséquence, il convient de préparer d’ores et déjà la mise en place d’un système complémentaire de capitalisation, par la mise en place d’un fonds de pension souverain, qui pourra apporter une retraite complémentaire, le moment venu, non pas sur la distribution de son capital, mais des revenus de celui-ci.
● Par ailleurs, faut-il continuer à faire peser sur le seul travail, le coût de notre politique sociale ? C’est pour moi une aberration, qui limite notre compétitivité et le pouvoir d’achat des salariés. Il faut, donc introduire progressivement le financement par la TVA sociale pour que les charges sociales pèsent moins sur les salaires et que les importations étrangères participent ainsi à l’opération.
Comme on peut le voir, le « il n’y a qu’à, il faut qu’on » n’a rien faire dans un dossier essentiel sur le plan social mais aussi économique.
Conclusion,
En toutes choses, il faut sortir des idéologies et regarder le réel en face, pour mieux l’affronter”.
Claude Barate, universitaire, député honoraire