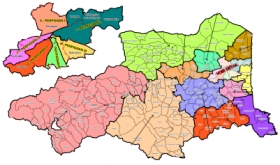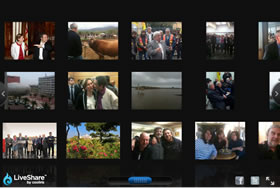(Vu sur la Toile)
Directive européenne, Macron, Bayrou… D’où vient cette histoire de durcissement du découvert bancaire ?
(Article de Jade Toussay • Rédaction Le Huffington Post)
Le Huffington Post.- L’information concerne au moins 8 % des Français et pourtant elle était passée relativement inaperçue jusqu’à cette fin octobre : à partir de novembre 2026, les règles de découverts bancaires vont être considérablement durcies. Cette petite révolution pour les ménages a été confirmée par la Banque de France le 28 octobre, provoquant immédiatement un tollé chez certains responsables politiques.
–« Alerte ! Être à découvert sera bientôt interdit ! (…) Cette privation a été imposée par l’Europe » s’indigne sur X le fondateur de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, pendant qu’à l’Assemblée, ses députés annoncent le dépôt une proposition de loi pour abroger cette mesure. Dans la journée, c’est le LR Laurent Wauquiez qui s’en est ému : « L’Union européenne ne trouve rien de mieux à faire que d’interdire les découverts bancaires automatiques. » Même agacement au RN, où le député Matthias Renault en profite pour ressortir un amendement déposé en novembre 2024 pour contrer le dispositif.
Mais d’où sort cette mesure ? A-t-elle vraiment été permise uniquement grâce à une ordonnance signée par Emmanuel Macron et son Premier ministre de l’époque François Bayrou alors que la France était (déjà) en pleins débats budgétaires pour 2025 ? Le HuffPost fait le point.
Première étape : l’échelle européenne
Retour en 2020. La Commission européenne se saisit d’une directive de 2008 qui encadre entre autres les règles du crédit à la consommation dans l’UE. Le texte est jugé obsolète, à la lueur des nouvelles pratiques bancaires, des évolutions technologiques et des changements d’habitudes des consommateurs.
Les mini-crédits – des prêts de quelques centaines d’euros – et les paiements en plusieurs fois sont devenus légion. La Commission décide donc de revoir les règles existantes, la fabrique de la loi européenne suit son cours et en décembre 2022, le dossier législatif est bouclé dans les grandes lignes.
Le site du Parlement européen en résume quelques-unes ainsi : « Pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions éclairées, le prêteur devra s’assurer qu’ils ont facilement accès à toutes les informations nécessaires avant la signature du contrat, notamment le coût total du crédit. Les prêteurs devront également procéder à une évaluation de la solvabilité du consommateur. »
Le texte final, devenu une « directive européenne » sur « le crédits aux consommateurs » est composé de cinquante articles consultables ici et adopté en commission le 22 mai 2023. Il est ensuite soumis au vote du Parlement en séance plénière en septembre de la même année et très largement adopté.
Selon le détail des votes disponible que nous avons pu consulter, tous les eurodéputés français ayant participé à la séance y étaient favorables, à l’exception de Jordan Bardella. François-Xavier Bellamy et Manon Aubry ont voté pour et l’insoumise s’en explique sur son site, évoquant un texte qui « va dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs », notamment parce qu’il encadre la publicité « pour être transparent sur les conditions de crédit. »
Deuxième étape : la transposition française
Parce qu’il est une « directive européenne », ce texte doit impérativement être transposé dans la loi nationale, faute de quoi la France « s’expose à une procédure de manquement devant la cour de justice de l’UE. » Les Etats-membres ont jusqu’au 25 novembre 2025 pour la promulguer. En France, cette traduction passe d’abord par un projet de loi présenté en Conseil des ministres le 31 octobre 2024, en procédure accélérée. Le ministre de l’Économie s’appelle Antoine Armand et le Premier ministre, Michel Barnier.
Le gouvernement ne présente pas une loi spécifique pour transposer cette directive. Elle est incluse dans un texte plus large « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ». C’est cette loi qui autorise le gouvernement à procéder par « ordonnance » pour traduire en France la directive européenne.
Troisième étape : l’ordonnance
Le 4 décembre, Michel Barnier est censuré, son successeur François Bayrou est nommé et le texte poursuit son cheminement parlementaire. Il est d’abord discuté à l’Assemblée, en commission puis en séance avec à chaque fois le dépôt d’amendements. Deux groupes s’opposent à la procédure par ordonnances : Rassemblement national et France insoumise qui chacun dépose des amendements. Si les débats passent inaperçus à l’époque, les deux formations remettent en avant ce mercredi leur prise de position, le RN pour dénoncer « l’ingérence de l’UE » contre laquelle il se pose en défenseur, les insoumis pour fustiger « le RN et les socialistes (qui) se sont abstenus sur cette loi. »
Le projet de loi est finalement adopté à l’Assemblée le 17 février, lors « d’une de ces séances humiliantes (…) où l’on vote des dizaines de “transpositions” d’un seul coup », fustige Jean-Luc Mélenchon. Un mois plus tard, il obtient le feu vert des sénateurs et finit son parcours par une commission mixte paritaire conclusive en mars. Un tour au Conseil constitutionnel plus tard, la loi est promulguée le 30 avril 2025. Un parcours on ne peut plus classique.
Accrochez-vous, ce n’est pas (tout à fait) fini pour autant. Le 3 septembre 2025, le Conseil des ministres est saisi d’une ordonnance sur le crédit à la consommation, prise « sur le fondement » de la loi adoptée en avril. Le ministre de l’Économie de l’époque est alors Éric Lombard et il insiste dans sa présentation en Conseil des ministres sur le fait que « la directive laisse (…) peu d’options aux Etats-membres au stade de la transposition. » Le point a beau être factuel, il ne manquera pas d’être reproché au chef de l’État par les oppositions, toujours promptes à s’emparer de sujets très concernant pour les Français. Quitte à désavouer au passage certains de leurs propres votes.
(Source : Le Huffington Post)