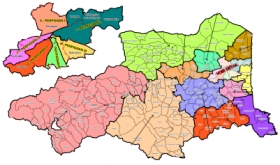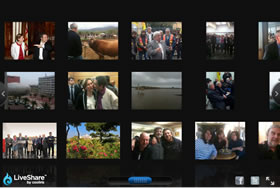Tribune Libre/ Claude Barate* : “La réforme des retraites, un enjeu de l’élection”
par adminLuc le Juin 25, 2024 • 7 h 07 min Aucun commentaire*Par Claude Barate universitaire, député honoraire
-“L’enjeu principal de l’élection législative est, sans aucun doute, le redressement de la France : rétablir l’ordre, la sécurité des français, la maitrise d’une immigration qui doit s’assimiler et rétablir le pouvoir d’achat des français, en même temps que la grandeur de la France.
Je ne reviendrai pas sur ces divers objets de toute action, mais il me parait utile de bien poser le problème des retraites qui sont en projet de modification aussi bien dans les propositions du Nouveau Front Populaire que du RN.
L’organisation des retraites en France pour les salariés a été mise en place en 1945 après le 2e guerre mondiale, par le gouvernement d’union nationale du général de Gaulle, le ministre concerné étant le communiste Ambroise Croizat.
L’assurance vieillesse mise en place est obligatoire pour tous les salariés.
On aurait pu choisir un système de retraite par capitalisation, on aurait pu choisir un système mixte avec un minimum de retraite pour chaque Français payé par les impôts, laissant à chacun le soin de se financer librement pour le reste.
Non, le choix a été fait d’une retraite dite de solidarité intergénérationnelle, dans laquelle les actifs paient la retraite des retraités. Le côté moral du principe ne se pose pas. En effet, il parait logique que les ainés après avoir payé pour élever les enfants, reçoivent de ceux-ci, un retour de solidarité ?
Le problème actuel n’est pas lié aux principes mais à l’augmentation de l’espérance de vie.
En 1945, l’espérance de vie des hommes était de 60 ans et celui des femmes de 65 ans. En mettant en place le régime à l’époque, avec un départ à la retraite pour tous à 65 ans, A.Croizat ne prenait pas trop de risque d’avoir un régime déficitaire.
En 2023-24, la situation a changé, puisque l’espérance de vie des hommes est de 80 ans et celle des femmes de 87,7 ans.
En 1945, il y avait de très nombreux cotisants pour un bénéficiaire, il y avait encore 2,1 cotisants au début des années 2000, mais en 2023, nous sommes tombés à 1,7 et en 2060 nous devions être à 1,3. On voit bien que la charge sur les actifs devient insupportable.
Les Français, malheureusement, ne rentrent jamais dans des considérations financières.
Ainsi en 1981, François Mitterrand leur a dit que l’Âge de la retraite pouvait passer de 65 à 60 ans, ils se sont immédiatement réjouis de cette mesure dite de justice sociale !
Ce qu’ils n’ont pas vu, c’est que du même coup, les cotisations des salariés augmentaient de même que le prix de revient des produits fabriqués en France. Cette analyse n’est pas idéologique, elle est mathématique.
Prenons le modèle démographique d’un homme qui rentre dans la vie active à 20 ans, prend sa retraite à 65 ans et meurt à 80 ans.
Avec un âge de retraite à 65 ans, ce qui était le cas avant la réforme Mitterrand, il y avait dans ce cas de figure, 3 cotisants pour un bénéficiaire : en effet la vie active est divisée en période de quinze ans (20 ans-35, 35 50- et 50-65) et il bénéficie d’une période de retraite de quinze ans, (65 à 80).
En baissant l’âge de la retraite à 60 ans, il ne reste plus que 2 cotisants (20-40 et 40-60) pour 1 bénéficiaire (60- 80).
La réforme Mitterrand a eu comme effet de supprimer un cotisant sur 3 et de reporter sur les 2 autres la charge antérieurement dévolue au 3e. Ce qui a eu comme conséquence financière immédiate d’augmenter d’autant le prix de revient des produits fabriqués et donc une augmentation des prix sur le marché, en même temps que d’une diminution du pouvoir d’achat des salariés qui ont vu augmenter leur contribution personnelle. Cette analyse n’est pas politique ou philosophique, elle est mathématique et irréfutable.
Alors il faut savoir que toute baisse de l’âge de départ à la retraite a un coût pour le cotisant et une augmentation des prix des produits français.
Est-il interdit d’apporter quelques légères modifications, dites de justice sociale, par exemple pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt ? Bien sûr que non, mais il faut savoir que cela a des conséquences.
Comme je l’ai déjà dit dans ces pages, nous arrivons au bout d’un système de répartition. La charge financière y repose sur le travail, ce qui pénalise « en même temps » le pouvoir d’achat des salariés et la compétitivité de nos entreprises face à des produits importés qui n’ont pas les mêmes charges.
Conséquence, même si les syndicats ne peuvent plus gérer des caisses de retraites qui seraient financées par la fiscalité sur les produits, il est grand temps de passer à un financement de TVA sociale, dont aucune formation ne parle encore”.
*Par Claude Barate universitaire, député honoraire