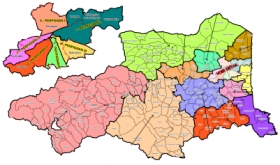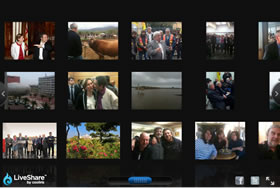*par Claude Barate, Universitaire, député honoraire
Les récents événements dressant une fois de plus Police et Justice, ont conduit à bien de déclarations approximatives sur la nature de l’institution judiciaire. On a dit à son sujet à peu près tout et son contraire. C’est pourquoi, j’ai entendu avec plaisir, une fois n’est pas coutume, la présidente du syndicat de la Magistrature, Mme Kim Reuflet, déclarer à la télévision, qu’il s’agissait « d’une autorité judiciaire indépendante ». J’aurais préféré qu’elle ajoute « et impartiale », mais visiblement ce n’était pas sa préoccupation. Pourtant c’est bien ainsi que les problèmes doivent être posés.
Et d’abord, s’agit-il d’un pouvoir ou d’une autorité ? Un de mes anciens étudiants à l’Université, qui a fait une carrière brillante dans la Magistrature, a dit un jour à la télévision que « la justice était un pouvoir » et que le Général de Gaulle avait eu tort de ne pas le mentionner ainsi dans la Constitution. J’aurais aimé pouvoir lui dire son erreur. La présidente du syndicat de la Magistrature a raison.
La justice en France, n’est qu’une autorité administrative.
Ne sont pouvoirs en démocratie, que l’exécutif et le législatif qui émanent directement du peuple par l’élection. A défaut d’être élue, la justice ne peut être qu’une autorité administrative indépendante.
Certes dans « L’Esprit des lois », le philosophe Montesquieu a pu déclarer en 1748, qu’il fallait que le pouvoir soit scindé en Pouvoir exécutif, législatif et judiciaire.
Mais, à l’époque, le roi détenait tous les pouvoirs et Montesquieu souhaitait protéger les individus de l’arbitraire royal. Constatant que « tout homme qui a du pouvoir est tenté d’en abuser », il proposait, pour protéger les individus, la division du pouvoir royal « pour que le pouvoir arrête le pouvoir ».
Cependant sa célèbre proposition ne s’inscrivait pas dans un régime démocratique où le pouvoir découle de l’élection par le peuple, mais dans la simple division politique du pouvoir royal.
Bref, à défaut d’être élus, les magistrats ne peuvent prétendre à l’exercice d’un pouvoir. Ils ne sont que l’autorité judiciaire !
Doivent-ils être indépendants ?
La réponse normale devrait être, oui.
Ce qui est certain, c’est qu’ils ne devraient pas pouvoir être sous le contrôle de l’exécutif, ou du législatif. Mais la contrepartie de cette indépendance devrait être l’impartialité.
Certes, le fait d’appliquer une législation votée par le pouvoir législatif donne déjà un élément d’impartialité, mais qui ne voit qu’au nom du principe de l’application personnalisée des peines, la marge d’intervention du juge est immense.
Et, qui pourrait supporter des jugements établis sur la base d’idées dogmatiques ou engagées. Qui pourrait supporter que les juges aient un engagement partisan. Heureusement que « le mur des cons » a disparu, mais quand même… !
Dans l’intérêt de la justice, des justiciables et des juges eux-mêmes, il faut donc trouver des moyens qui permettent l’indépendance d’une justice impartiale et comprise par la population.
Il n’est plus possible d’attendre de longues années pour qu’un procès soit obligé d’attendre l’appel pour être purgé, qu’une erreur de transmission sur un mot sans importance, entraine une annulation de 10 ans de procédure et la libération d’un criminel, ou que la libération hasardeuse d’un criminel entraine un nouveau crime.
La justice des hommes doit être au service du bon sens et non au service d’un droit légal ou jurisprudentiel qui n’a de sens que par rapport à lui-même. Le droit ne doit pas être à son service, mais à celui des hommes.
Par ailleurs, les juges ne peuvent rester le seul corps de la Nation sans responsabilité.
Il faut donc trouver les moyens de leur donner de la force, en les rendant responsables de leurs actes.
Force est de constater que la justice est rendue au nom du peuple français, sans que le peuple français ait jamais rien à dire sur la manière dont la justice est rendue en son nom.
Certes un organe corporatiste, le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), assure un certain contrôle, mais si on ne veut pas que les juges soient soumis à la légitimité, mais aussi à la force de l’élection, alors ils doivent chercher cette force et cette légitimité dans le contrôle par le peuple de leur action.
Si on ne veut pas apporter ces corrections, alors il ne faudra pas s’étonner qu’en 2023, 73% de français aient une image positive de la police et seulement 44% de la justice.
C’est pourquoi je suggère la mise en place du contrôle des juges, par un comité de sages élus à la proportionnelle, lors de chaque élection présidentielle, avec une double mission, informer la population sur l’état de la justice, sanctionner le cas échéant les fautes des juges.
Ainsi serait respectée l’indépendance des juges face au pouvoir législatif ou exécutif, tout en les rendant responsables, et donc légitimes, devant une émanation du peuple.
Claude Barate